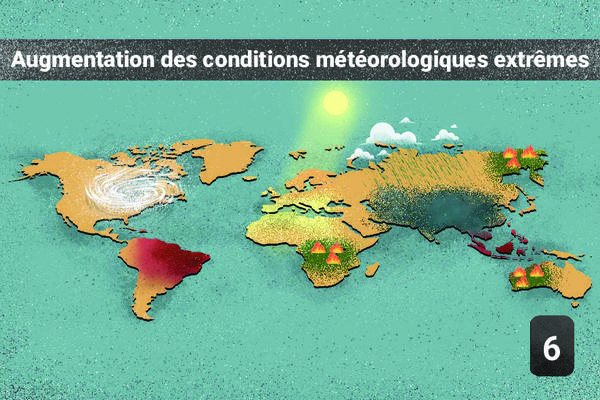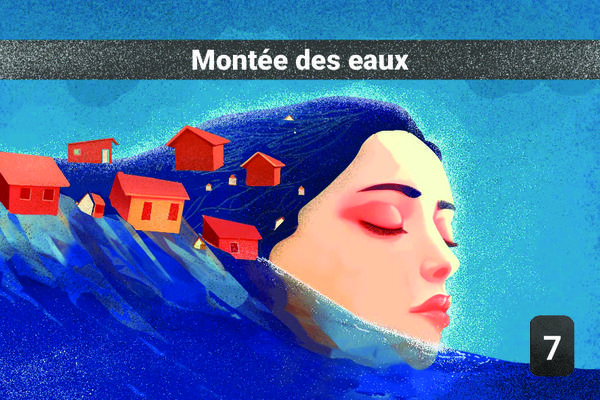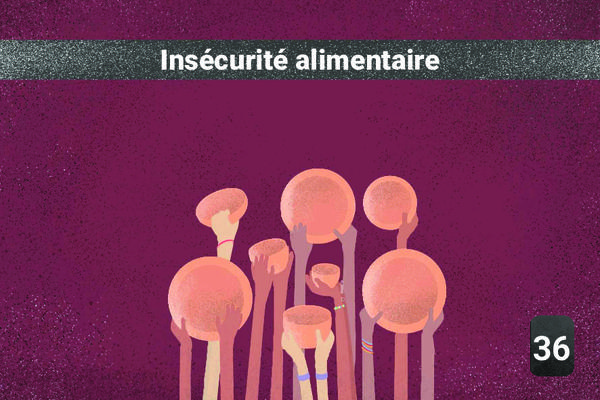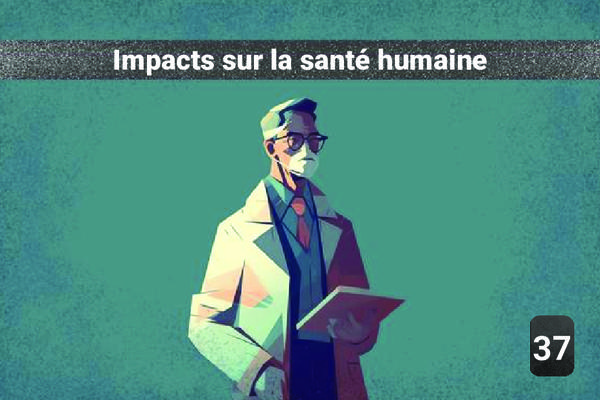42 - Accroissement des inégalités

✏️ Cette explication n'est pas encore disponible dans ta langue, clique ici pour proposer ta traduction ou écris un email à fdn.memo@marc-antoinea.fr.
3Causes
Les guerres favorisent les inégalités, car elles bouleversent les structures économiques, sociales et politiques de manière à concentrer les richesses et le pouvoir entre les mains de certains, tout en aggravant la vulnérabilité des autres. Voici pourquoi : Destruction inégale des ressources : Les guerres détruisent infrastructures, terres et habitations, mais les pauvres, qui dépendent souvent de ces biens pour survivre (ex. : agriculteurs), perdent tout sans moyen de se relever. Les riches, avec des actifs diversifiés (comptes bancaires, propriétés à l’étranger), sont moins affectés ou peuvent même profiter de la reconstruction. Économie de guerre et profits opportunistes : Les conflits créent des marchés parallèles (armes, pillages, contrebande) qui enrichissent une minorité : chefs de guerre, trafiquants ou entreprises liées au pouvoir. Pendant la guerre en Syrie, par exemple, certains proches du régime ont amassé des fortunes, tandis que la population s’appauvrissait. Déplacement des populations : Les guerres forcent des millions de personnes à fuir, devenant réfugiés ou déplacés internes. Ces groupes perdent terres, emplois et épargne, tombant dans la précarité, tandis que ceux restés en sécurité ou ayant des réseaux conservent ou accroissent leur statut.
Les extrêmes climatiques augmentent les inégalités car ils affectent de manière disproportionnée les populations et les régions en fonction de leur richesse, de leur localisation et de leur capacité à faire face aux conséquences. Voici les raisons principales : Vulnérabilité géographique inégale : Les populations pauvres vivent souvent dans des zones plus exposées, comme les plaines inondables, les côtes ou les régions arides (ex. : bidonvilles en Inde, villages au Sahel). Les riches, eux, habitent généralement des endroits mieux protégés ou peuvent déménager facilement, échappant ainsi aux pires impacts des tempêtes, inondations ou sécheresses.
Capacité d’adaptation limitée : Les pays ou individus aisés ont les ressources pour se prémunir ou se relever des extrêmes climatiques : assurance, infrastructures résistantes (digues, bâtiments renforcés), accès à la technologie (irrigation, climatisation). Les pauvres, en revanche, manquent de moyens pour investir dans ces protections ou pour reconstruire après une catastrophe.
La montée des eaux, liée au changement climatique (fonte des glaces et dilatation thermique des océans), provoque une augmentation des inégalités car elle affecte de manière disproportionnée les populations et les régions en fonction de leur situation géographique, de leurs ressources économiques et de leur capacité d’adaptation. Voici des raisons. Vulnérabilité géographique inégale : les zones côtières basses, comme les deltas (ex. : Bangladesh, Vietnam) ou les petites îles (ex. : Maldives, Tuvalu), sont les plus exposées. Ces régions abritent souvent des populations pauvres dépendant de la pêche ou de l’agriculture, qui perdent leurs moyens de subsistance face à l’inondation des terres et à la salinisation des sols. Les pays ou communautés riches, situés en altitude ou mieux protégés, sont moins touchés. Capacité d’adaptation limitée : les pays développés ou les populations aisées peuvent investir dans des infrastructures (digues, relocalisation, systèmes de drainage), tandis que les pays pauvres ou les communautés marginalisées n’ont pas les moyens financiers ou techniques pour se protéger. Par exemple, les Pays-Bas construisent des défenses sophistiquées, mais Haïti ou les bidonvilles côtiers n’ont pas cette option. Déplacement des populations : la montée des eaux force des millions de personnes à migrer, créant des « réfugiés climatiques ». Ces déplacements touchent surtout les plus démunis, qui perdent leurs maisons et terres sans pouvoir se réinstaller facilement. Les populations riches ou influentes, elles, accèdent plus vite à des zones sûres ou à des compensations.
3Conséquences
L’accroissement des inégalités a des conséquences sur les famines car il limite l’accès équitable aux ressources alimentaires et fragilise la capacité des populations les plus pauvres à faire face aux crises. Voici les raisons principales : Inégalités d’accès à la nourriture : Les riches peuvent acheter des aliments même en période de pénurie, grâce à leur pouvoir d’achat, tandis que les pauvres, avec des revenus insuffisants, ne le peuvent pas. Lors de hausses de prix (ex. : crise alimentaire de 2007-2008), les plus démunis sont les premiers à souffrir de la faim. Concentration des terres agricoles : Les inégalités favorisent l’accaparement des terres par de grandes entreprises ou des élites, privant les petits agriculteurs de leurs moyens de production. Au Soudan du Sud ou en Éthiopie, par exemple, cette perte d’accès à la terre réduit la capacité des communautés à cultiver leur propre nourriture, les rendant vulnérables aux famines. Dépendance aux marchés instables : Les pauvres, souvent exclus de la production agricole, dépendent de l’achat de nourriture. Quand les inégalités creusent l’écart de revenu, ils n’ont pas les moyens d’absorber les chocs économiques (inflation, spéculation), contrairement aux riches qui maintiennent leur approvisionnement. Faiblesse des filets de sécurité : Dans les sociétés inégalitaires, les gouvernements ou les institutions négligent souvent les programmes d’aide (subventions, réserves alimentaires) pour les plus démunis. Pendant la famine au Yémen, exacerbée par la guerre, les populations pauvres ont été abandonnées tandis que les mieux lotis trouvaient des alternatives.
L’accroissement des inégalités a des conséquences sur la santé car il crée des écarts dans l’accès aux soins, aux conditions de vie et aux ressources nécessaires pour rester en bonne santé. Voici les raisons principales : Accès inégal aux soins médicaux : Les plus riches peuvent se payer des médecins, des hôpitaux privés ou des traitements coûteux, tandis que les pauvres dépendent de systèmes publics souvent sous-financés ou inexistants. Par exemple, dans des pays comme les États-Unis, l’absence d’assurance santé touche surtout les bas revenus, augmentant leur risque de maladies non traitées. Conditions de vie dégradées : Les inégalités relèguent les moins favorisés dans des logements insalubres (humidité, pollution), des quartiers dangereux ou des zones sans eau potable. Ces environnements favorisent les maladies respiratoires, infectieuses ou chroniques, comme l’asthme ou le choléra, contrairement aux riches qui vivent dans des cadres plus sains. Insécurité alimentaire : Les pauvres ont moins accès à une alimentation variée et nutritive, ce qui entraîne malnutrition, obésité (due à des aliments bon marché mais peu sains) ou carences (ex. : manque de vitamines). Les riches, eux, maintiennent une meilleure qualité de vie grâce à une nourriture équilibrée.
L’accroissement des inégalités et les conflits armés sont liés car les disparités économiques, sociales ou politiques créent des tensions qui peuvent dégénérer en violence organisée. Voici les raisons principales de cette connexion : Frustration et ressentiment : Quand une partie de la population est exclue des richesses, des opportunités ou du pouvoir (ex. : élites corrompues vs masses pauvres), cela génère de la colère. Ce sentiment d’injustice pousse les groupes marginalisés à se révolter comme dans les printemps arabes (ex. : Tunisie, 2011). Compétition pour les ressources : Les inégalités amplifient la lutte pour des ressources limitées (eau, terre, pétrole). Les plus démunis, voyant les élites accaparer ces biens, peuvent s’armer pour les revendiquer. Au Soudan du Sud, par exemple, les inégalités dans l’accès aux terres fertiles ont alimenté des conflits ethniques armés. Faiblesse des institutions : Dans les sociétés inégalitaires, les gouvernements sont souvent perçus comme illégitimes ou incapables de redistribuer équitablement les richesses. Cette perte de confiance favorise l’émergence de factions armées qui contestent l’autorité, comme en Colombie avec les FARC, nées des inégalités rurales.